L’arrêt du 18 juin 2025 rappelle avec force que la valeur d’une enquête interne dépend de sa complétude et de son objectivité. Lorsqu’elle est incomplète, elle peut fragiliser la procédure disciplinaire et conduire à la requalification du licenciement. Voici l’essentiel à retenir :
La protection de la santé et de la sécurité des salariés constitue une obligation cardinale de l’employeur. L’article L. 4121-1 du Code du travail impose à l’entreprise de prendre toutes mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Cette obligation inclut la prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel ainsi que des agissements sexistes.
L’article L. 1152-4 précise que l’employeur doit prendre toutes dispositions nécessaires pour prévenir les agissements de harcèlement moral. De la même manière, l’article L. 1153-5 prévoit des mesures spécifiques en matière de harcèlement sexuel. Autrement dit, dès la survenance d’un signalement ou d’un indice laissant supposer de tels comportements, l’entreprise doit réagir de manière immédiate et adaptée.
Contrairement à ce que l’on pourrait croire, le Code du travail ne fait pas de l’enquête interne une étape obligatoire. L’absence d’enquête ne caractérise pas, en soi, un manquement à l’obligation de sécurité. Toutefois, dans la pratique, elle est devenue un instrument de gestion essentiel.
Conduire une enquête interne présente plusieurs avantages :
De plus, une méthodologie claire a récemment été diffusée par le Défenseur des droits afin d’aider les entreprises à sécuriser leur démarche d’enquête.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 18 juin 2025, a apporté une précision de taille : un rapport d’enquête incomplet peut être jugé non probant.
Dans cette affaire, un directeur associé avait été licencié pour faute, après que plusieurs collaboratrices eurent dénoncé des propos et comportements à connotation sexuelle. L’employeur avait diligenté une enquête interne mais n’avait produit qu’une partie des éléments recueillis :
La cour d’appel a estimé que l’enquête n’était pas suffisamment probante et que le licenciement devait être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse. La Cour de cassation a confirmé ce raisonnement en rappelant que les juges du fond apprécient souverainement la valeur probante d’un rapport d’enquête, et que le doute profite au salarié (art. L. 1235-1 du Code du travail).
A lire : qu'est que la mise à pied d'un salarié en cas de soupcons de harcèlement ?
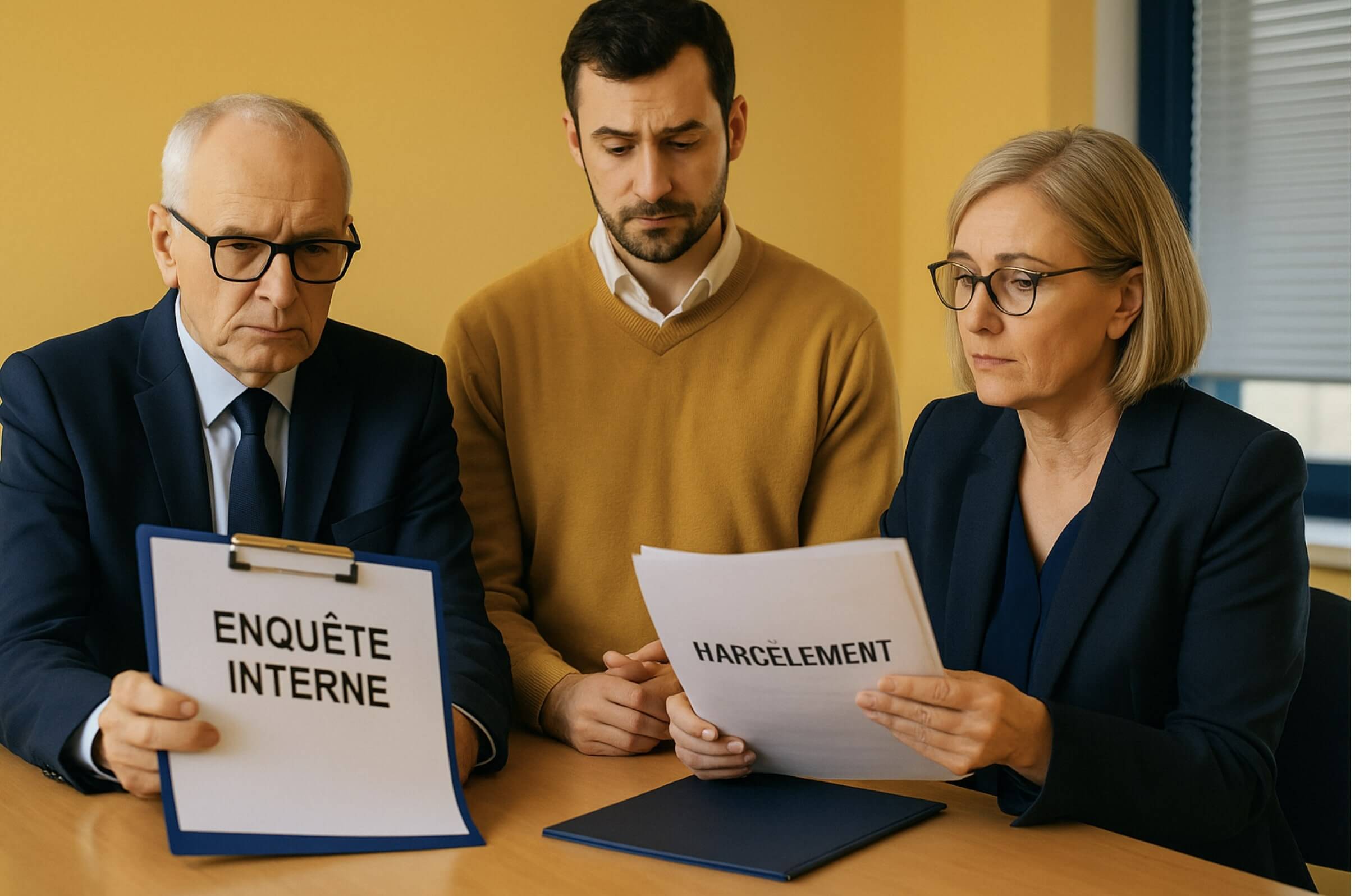
L’arrêt du 18 juin 2025 met en lumière les principaux critères retenus par les juges pour apprécier la valeur d’un rapport d’enquête :
Une enquête partielle ou orientée est perçue comme biaisée. Elle perd alors son caractère probant et risque d’être écartée, fragilisant irrémédiablement la procédure disciplinaire.
Le droit du travail repose sur une règle protectrice essentielle : en cas d’incertitude sur les faits reprochés, le doute doit profiter au salarié. Ce principe est consacré par l’article L. 1235-1 du Code du travail et constamment réaffirmé par la jurisprudence.
Ainsi, même si des témoignages semblent incriminants, une enquête incomplète, contradictoire ou insuffisamment étayée ne peut justifier un licenciement disciplinaire. Le salarié bénéficie alors d’une protection renforcée, car l’employeur doit prouver de manière suffisamment précise et circonstanciée les griefs allégués.
Un point sensible soulevé dans cette affaire tient à la conciliation entre le droit à la preuve et le respect de la vie privée. L’employeur soutenait qu’il n’avait pas communiqué certains témoignages afin de préserver l’anonymat de salariés. Si cette préoccupation est légitime, la Cour rappelle qu’une anonymisation est possible et ne peut justifier à elle seule l’absence de transmission de pièces essentielles.
Ce raisonnement s’appuie sur l’article 9 du Code civil et sur les principes issus de la Convention européenne des droits de l’homme : toute restriction au droit à la preuve doit être proportionnée et justifiée.
Une enquête jugée non probante peut avoir des conséquences financières et organisationnelles lourdes :
À l’inverse, une enquête rigoureuse et documentée constitue un outil précieux pour protéger l’entreprise et sécuriser ses décisions disciplinaires.
Afin de limiter les risques de contestation, il est recommandé de :
L’arrêt du 18 juin 2025 comporte également une dimension liée au droit des données personnelles. La Cour rappelle que les courriels émis ou reçus par un salarié via sa messagerie professionnelle constituent des données personnelles au sens du Règlement général sur la protection des données (RGPD).
Le salarié est en droit d’obtenir communication de ces données, y compris des métadonnées (horodatage, destinataires), sauf si cette communication porte atteinte aux droits d’autrui. Le refus de l’employeur peut être sanctionné par l’octroi de dommages-intérêts.
L’enseignement majeur de cette décision est clair : une enquête interne n’est pas une obligation légale, mais si l’employeur choisit d’en produire une, elle doit être complète, objective et transparente.
Pour les employeurs, la vigilance est de mise : un rapport lacunaire ne convaincra pas les juges et risque d’aboutir à la reconnaissance d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Pour les salariés, cette jurisprudence constitue une garantie : le principe du doute et la recherche d’objectivité continuent de jouer en leur faveur.
La conduite d’une enquête interne sur des faits de harcèlement exige donc méthode, impartialité et prudence. Elle engage à la fois la responsabilité juridique et l’image de l’entreprise, et doit s’inscrire dans une démarche de prévention globale et rigoureuse.
A lire : qu'est que la faute inexcusable de l'employeur vis à vis d'un salarié ?
Le Code du travail n’impose pas explicitement la réalisation d’une enquête interne lorsqu’un salarié dénonce des faits de harcèlement moral, sexuel ou d’agissements sexistes. L’employeur est néanmoins tenu, au titre de son obligation générale de sécurité (articles L. 4121-1 et suivants), de prendre toutes mesures nécessaires pour prévenir et faire cesser de tels comportements.
Dans les faits, l’enquête interne est devenue une pratique fortement recommandée. Elle permet de recueillir rapidement des éléments objectifs, de protéger les salariés concernés et de démontrer que l’employeur agit avec diligence. Ne pas en réaliser peut fragiliser la défense de l’entreprise en cas de contentieux.
Une enquête menée de façon partielle ou produite de manière incomplète devant le juge peut être jugée non probante. C’est précisément ce qu’a rappelé la Cour de cassation dans un arrêt du 18 juin 2025 : seuls cinq témoignages sur quatorze avaient été versés aux débats, certains passages étaient tronqués, et d’autres témoignages avaient été occultés.
Dans une telle situation, les juges considèrent que les éléments produits ne permettent pas d’établir la réalité des faits reprochés. Le licenciement disciplinaire qui en découle peut alors être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec toutes les conséquences indemnitaires que cela implique.
Pour qu’une enquête interne soit reconnue comme probante, elle doit respecter plusieurs exigences :
Une enquête respectant ces critères constitue un outil de défense efficace pour l’entreprise et un gage de transparence pour les salariés.
Oui. Le salarié mis en cause doit avoir la possibilité de connaître les éléments retenus à son encontre, afin de préparer utilement sa défense. Les témoignages peuvent être anonymisés pour protéger la vie privée des autres salariés, mais leur suppression totale est problématique.
Par ailleurs, la jurisprudence a rappelé que les courriels émis ou reçus via la messagerie professionnelle constituent des données personnelles. Le salarié est donc en droit d’en obtenir communication, sauf si cette transmission porte atteinte aux droits d’autrui. Ne pas satisfaire à cette demande peut constituer une violation de ses droits.
Le Code du travail, à son article L. 1235-1, consacre un principe protecteur essentiel : lorsque subsiste un doute sur la réalité des faits reprochés au salarié, ce doute doit profiter à ce dernier.
Autrement dit, si l’enquête interne est lacunaire ou contradictoire, et si les autres éléments du dossier ne permettent pas de lever l’incertitude, le licenciement sera jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse. Ce principe illustre l’équilibre que le droit du travail cherche à maintenir : protéger les victimes potentielles tout en garantissant la présomption d’innocence du salarié mis en cause.