Depuis le 1er septembre 2025, la retraite progressive est accessible à tous les assurés dès 60 ans, sous réserve de totaliser 150 trimestres. Ce dispositif, qui combine activité à temps réduit et perception partielle de la pension, devient un outil majeur de gestion des fins de carrière.

Le décret n° 2025-681 du 15 juillet 2025, publié au Journal officiel du 23 juillet 2025, modifie en profondeur l’accès à la retraite progressive. À compter du 1er septembre 2025, tous les assurés totalisant au moins 150 trimestres d’assurance pourront demander à bénéficier de ce dispositif dès l’âge de 60 ans, sans considération de leur année de naissance.
Jusqu’alors, la retraite progressive était réservée aux salariés remplissant les conditions de durée d’assurance et ayant atteint un âge fixé à « l’âge légal de départ à la retraite minoré de deux ans ». Concrètement, pour les assurés nés à compter de 1968, cela correspondait à 62 ans. Le passage à 60 ans marque donc une rupture notable, en ouvrant le dispositif de manière plus précoce et universelle.
Cette mesure s’inscrit dans la continuité de l’accord national interprofessionnel du 14 novembre 2024, conclu en faveur de l’emploi des salariés expérimentés. L’objectif est clair : encourager le maintien en activité des seniors grâce à une transition progressive entre emploi et retraite, évitant ainsi les arrêts brutaux de carrière.
Le dispositif de retraite progressive est prévu à l’article L. 161-22-1-5 du Code de la sécurité sociale. Le décret de juillet 2025 modifie l’article D. 161-2-24 du même code, en remplaçant la référence à « l’âge légal abaissé de deux ans » par une formule simple : « 60 ans ».
Ce changement de rédaction n’est pas anodin : il uniformise le dispositif et met fin à la complexité liée à l’évolution de l’âge légal. Désormais, quel que soit l’âge légal applicable à la génération concernée, la retraite progressive sera accessible à partir de 60 ans.
Pour prétendre à la retraite progressive, deux conditions demeurent incontournables :
Le dispositif concerne un large public : salariés du régime général, non-salariés et salariés agricoles, professions libérales, avocats en droit du travail, ainsi que les affiliés à certains régimes spéciaux par le biais du décret parallèle n° 2025-680 du 15 juillet 2025.
A lire : peut-on cotiser à le retraite pendant un arrêt maladie ?
La retraite progressive permet de percevoir une fraction de sa pension de retraite de base et complémentaire tout en continuant à exercer une activité professionnelle. Le salarié voit donc ses revenus composés d’une part de salaire (réduit) et d’une part de pension.
Le pourcentage de pension versée dépend de la quotité de travail effectuée. Plus la durée de travail est réduite, plus la part de retraite versée est élevée. Par ailleurs, les trimestres continuent d’être validés, ce qui permet d’améliorer le montant de la pension définitive lorsque le salarié liquidera ses droits à taux plein.
Le régime de retraite complémentaire Agirc-Arrco s’aligne sur le dispositif de retraite progressive tel que prévu par le Code de la sécurité sociale. Concrètement, un salarié bénéficiant de la retraite progressive dans le régime de base percevra également une fraction de ses droits complémentaires, ce qui rend le dispositif attractif pour les cadres et assimilés.
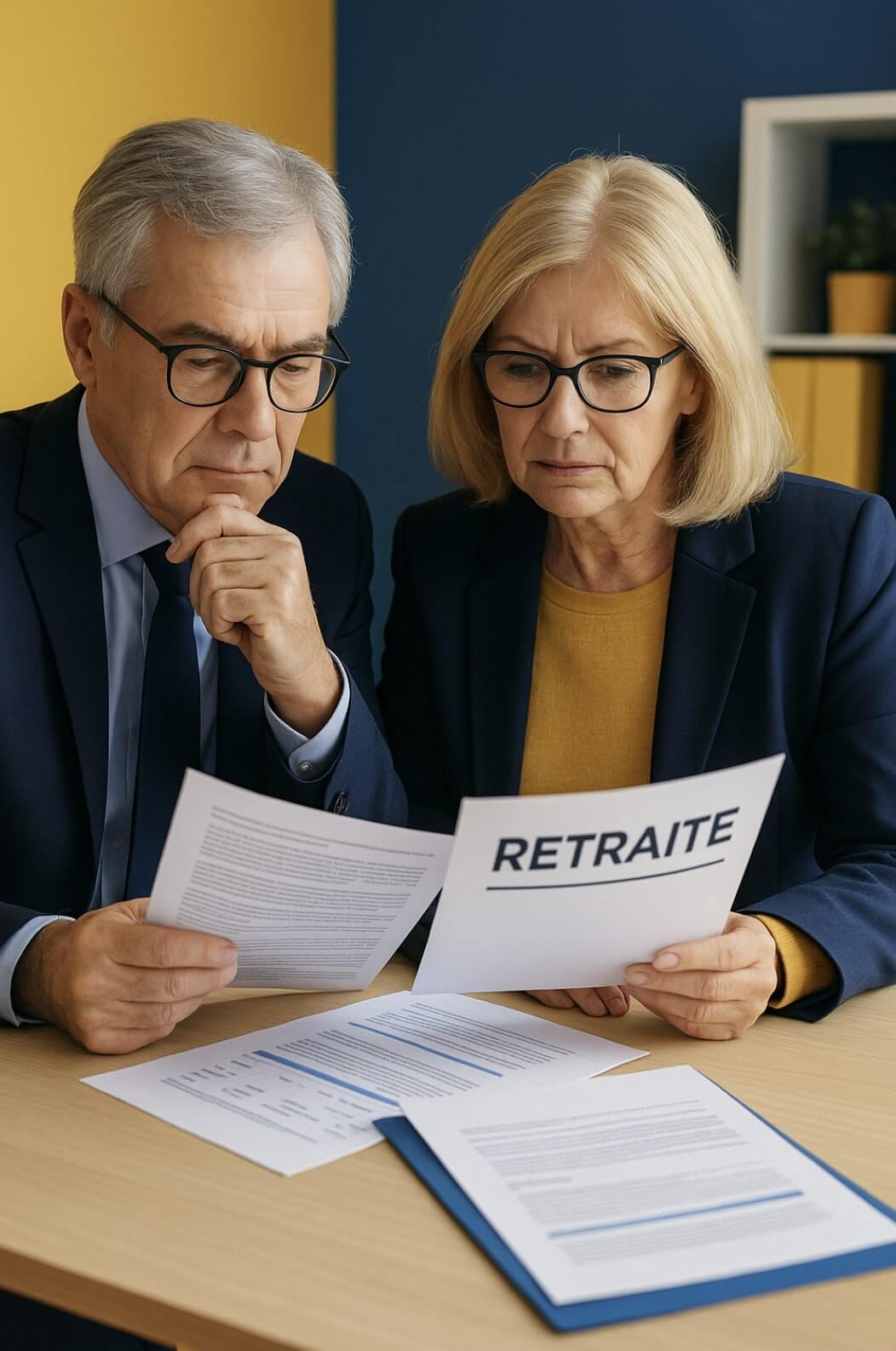
Lorsqu’un salarié remplit les conditions légales et sollicite un passage en retraite progressive, l’employeur dispose d’un délai de deux mois pour répondre. Son silence vaut acceptation. Seule une incompatibilité objective de la demande avec les nécessités économiques de l’entreprise peut justifier un refus.
Le refus doit impérativement être motivé et notifié par lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai de deux mois. À défaut, l’accord est réputé acquis.
A lire : est-ce que les heures supplémentaires comptent pour la retraite ?
Le projet de loi portant transposition de l’accord national interprofessionnel de 2024 prévoit de durcir encore ce régime. À l’avenir, un employeur qui souhaiterait refuser une demande de retraite progressive devrait apporter une justification circonstanciée, démontrant :
Ce renforcement traduit une volonté politique d’encourager fortement le recours à la retraite progressive et de limiter les marges de manœuvre des employeurs.
La retraite progressive constitue un outil de souplesse pour les actifs proches de la retraite :
Cette transition est particulièrement adaptée aux salariés dont les métiers sont physiquement ou psychologiquement exigeants, mais qui souhaitent rester en activité partielle pour transmettre leur savoir-faire.
Pour les employeurs, la retraite progressive présente plusieurs avantages :
En contrepartie, l’employeur doit gérer la réorganisation du travail et, le cas échéant, procéder à un recrutement partiel. Les contraintes organisationnelles sont donc réelles, mais elles sont désormais moins reconnues comme motifs légitimes de refus.
Malgré ses atouts, la retraite progressive reste marginale : seuls 0,5 % des départs à la retraite passent par ce dispositif. Plusieurs raisons expliquent ce faible recours :
En comparaison, d’autres pays européens utilisent largement ce type de transition, ce qui souligne le retard français en matière de gestion des fins de carrière.
La retraite progressive dès 60 ans constitue une avancée sociale majeure, en offrant aux salariés une transition souple et sécurisée vers la retraite. Elle s’impose également comme un outil de gestion RH moderne, permettant aux entreprises de mieux accompagner les fins de carrière.
Toutefois, cette réforme accroît les obligations des employeurs et réduit leurs marges de manœuvre. Le régime de refus, déjà strict, devrait encore se resserrer. Dans ce contexte, il est essentiel pour les dirigeants d’anticiper les demandes et pour les salariés de se préparer soigneusement.
L’assistance d’un avocat en droit du travail permet d’accompagner chaque partie dans la mise en œuvre du dispositif, de sécuriser les procédures et de prévenir les litiges. Plus que jamais, la retraite progressive devient un enjeu stratégique, à la croisée des intérêts individuels et collectifs.
À partir du 1er septembre 2025, la retraite progressive est accessible dès 60 ans pour tous les assurés justifiant d’au moins 150 trimestres d’assurance. Il faut également exercer une activité à temps partiel ou réduit, comprise entre 40 % et 80 % de la durée légale ou conventionnelle de travail.
Le dispositif concerne l’ensemble des assurés : salariés du secteur privé, salariés et non-salariés agricoles, professions libérales, avocats, ainsi que certains régimes spéciaux. Le régime complémentaire Agirc-Arrco applique également la retraite progressive dès lors que les conditions sont remplies dans le régime de base.
Le principe est l’acceptation : le silence de l’employeur pendant 2 mois vaut accord. Le refus n’est possible que si la réduction du temps de travail est incompatible avec l’activité économique de l’entreprise. Ce refus doit être motivé et notifié par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le salarié perçoit une fraction de sa pension de retraite de base et complémentaire proportionnelle à la réduction de son temps de travail. Plus la durée de travail est faible, plus la fraction de pension est élevée. Pendant la période de retraite progressive, le salarié continue d’acquérir des droits qui amélioreront sa pension définitive lors de la liquidation totale.
La retraite progressive facilite la gestion des fins de carrière. Elle permet de maintenir en poste des salariés expérimentés tout en favorisant la transmission des compétences. Elle contribue à une meilleure gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, tout en offrant une transition plus douce que le départ en retraite brutal.